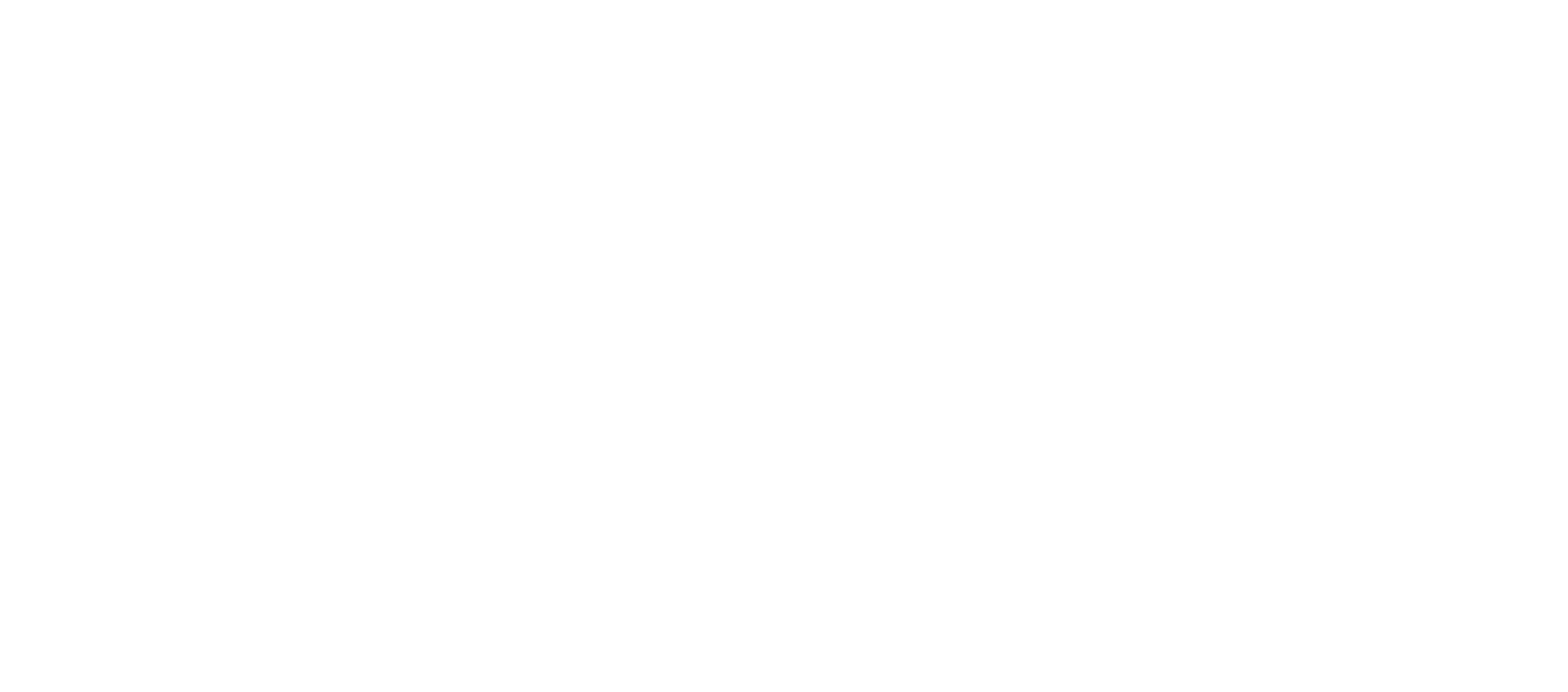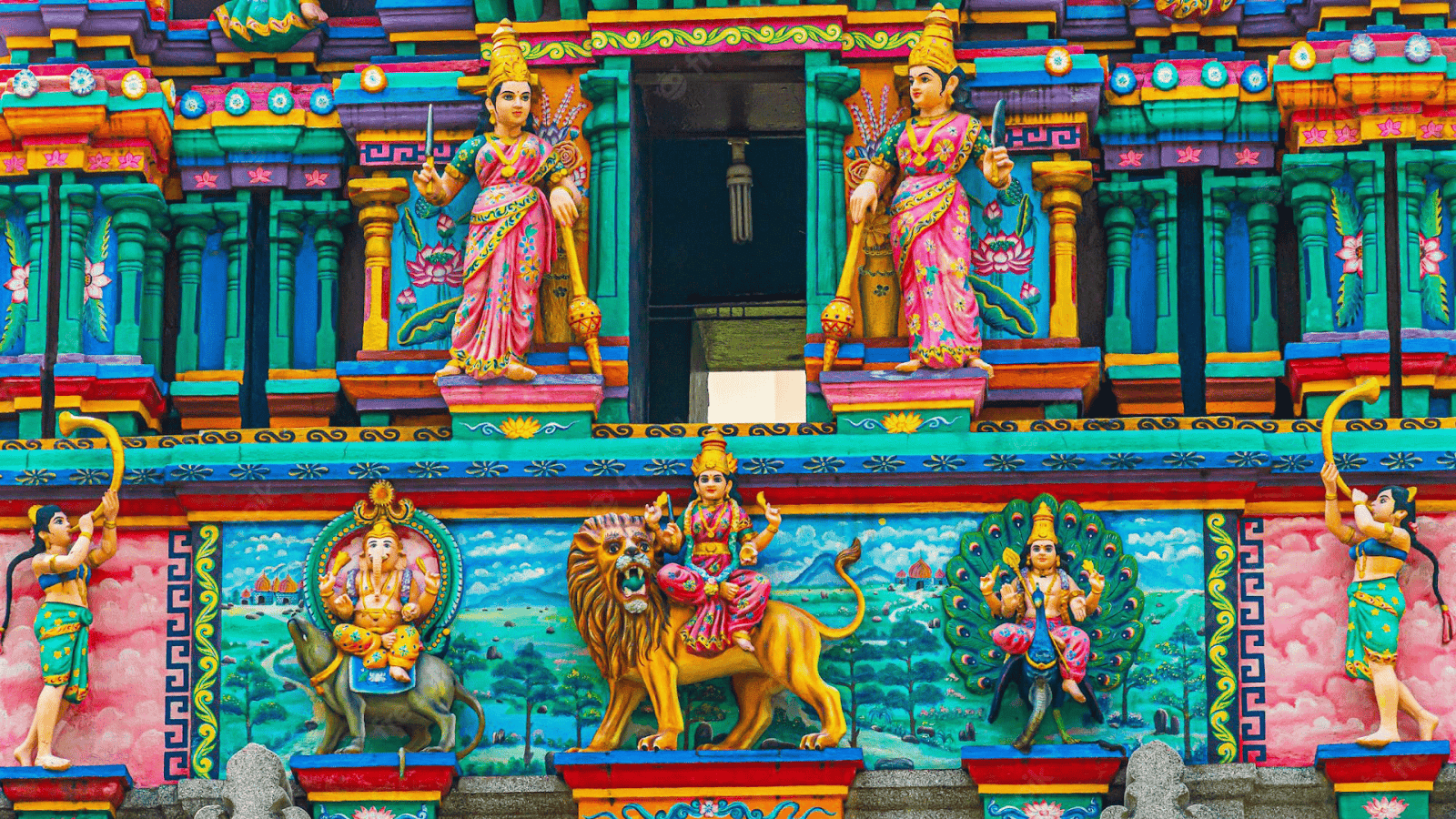Le Confucianisme au Vietnam: Une Philosophie Façonnant Société et Esprits
Plus qu'une simple religion, le confucianisme (Nho giáo ou Khổng giáo en vietnamien), fondé sur les enseignements du vénérable Confucius (551-479 av. J.-C.), est une philosophie morale, politique et sociale qui a profondément modelé la société vietnamienne. Il dicte à chacun sa place, ses droits et ses devoirs au sein de la famille et de la communauté, visant à assurer la paix et l'ordre.
Bien que Maître Kong n'ait jamais consigné ses théories par écrit – ce sont ses disciples qui rassemblèrent ses commentaires et aphorismes dans le Lunyu (Les Entretiens) – le confucianisme fut érigé en philosophie d'État par la dynastie chinoise des Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.) et pénétra au Vietnam à la même époque. Son influence sur les comportements sociaux vietnamiens est indéniable et durable.
Les Principes Fondamentaux du Confucianisme: Harmonie et Vertu
Selon Confucius, tout homme de bien doit cultiver deux principes complémentaires:
Jen (Nhân): la vertu, l'humanité, la bonté.
Yi (Nghĩa): la justice, la droiture.
Ces principes sont complétés par plusieurs qualités morales essentielles:
La piété filiale (Hiếu): assurée notamment par le culte des ancêtres, elle est la base de l'ordre familial et social.
Le respect des rites (Lễ) et des règles de préséance.
La loyauté (Trung) et la fidélité à la parole donnée (Tín).
Le courage (Dũng).
Confucius a également défini cinq "relations naturelles" (Ngũ Luân) auxquelles chacun doit se conformer pour assurer l'ordre et la cohésion sociale:
Père/Fils (Phụ tử): le fils doit obéir à son père sans réserve.
Homme/Femme (Phu phụ): la femme doit se conformer à son mari (bien que cette interprétation ait évolué).
Aîné/Cadet (Huynh đệ): le respect des aînés.
Ami/Ami (Bằng hữu): l'honnêteté et la confiance mutuelle.
Prince/Sujet (Quân thần): une relation de bienveillance réciproque, similaire à celle entre père et fils, où le souverain est le "père" de la nation.
Des rites complexes et précis permettent de sceller et de renforcer cet ensemble de relations. Pour être digne de gouverner, le prince (dirigeant) doit étudier et maîtriser les Cinq Classiques (Ngũ Kinh):
Le Livre des Odes (Kinh Thi)
Le Livre des Documents (Kinh Thư)
Le Livre des Rites (Kinh Lễ)
Les Annales des Printemps et Automnes (Kinh Xuân Thu)
Le Livre des Mutations (Kinh Dịch)
Il doit se conformer à leurs prescriptions, se montrer bienveillant envers ses sujets, et sa vertu royale devait, par son seul rayonnement, harmoniser la nature et la société.
Le Confucianisme dans l'Histoire du Vietnam: Un Héritage Complexe
Le confucianisme met un accent considérable sur l'éducation. Il promeut l'idée que la connaissance n'est pas un privilège de naissance, mais le fruit du mérite et de la détermination personnelle. Après un millénaire de présence chinoise et d'influences confucéennes, les empereurs de la dynastie Lý au XIe siècle ont institué les premiers concours mandarins (khoa cử) au Vietnam. Ces concours, en principe ouverts à tous (à l'exception des comédiens et des femmes), visaient à former les cadres de l'empire et exigeaient une connaissance parfaite des Cinq Classiques, mais aussi des principes bouddhistes et taoïstes.
En 1802, lorsque la dynastie Nguyễn réalisa la réunification du territoire vietnamien, le confucianisme fut élu doctrine officielle de l'empire. Cependant, cette forme de confucianisme, devenue figée et attachée à des valeurs et principes considérés comme immuables, fut malheureusement incapable de faire face aux bouleversements amorcés par l'ouverture sur l'Occident.
En effet, les colonisateurs français apportèrent avec eux les principes nouveaux des sciences exactes et de la révolution industrielle, que l'immobilisme des néo-confucéens de Huê rejeta avec dédain. L'extrême rigidité des mandarins entourant les derniers empereurs Nguyễn explique en partie la chute de cette dynastie. Malgré cette fin difficile, l'influence du confucianisme reste profondément ancrée dans les valeurs familiales, le respect des aînés, la soif d'apprendre et le sens des responsabilités qui caractérisent encore aujourd'hui la société vietnamienne.